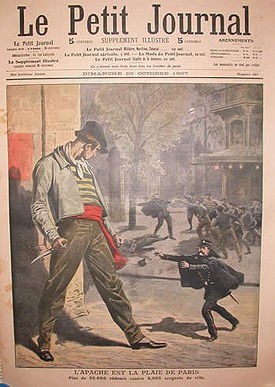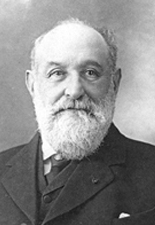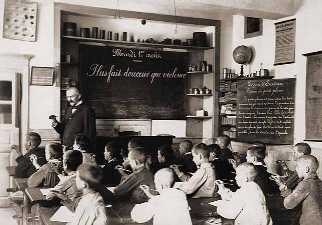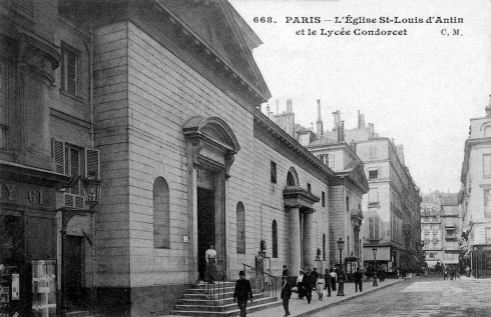« Mais monsieur, le téléphone, c’est pour les bavardages de dames ! » J’écoute avec attention la jeune comtesse de Pange qui sera reçue dans un quart d’heure par Aristide Briand. Mon interlocutrice semble très étonnée de l’entretien que je viens d’avoir en sa présence, grâce à cet appareil, avec la préfecture de police. Elle reprend : « Mais, chez moi, c’est un domestique – toujours le même – qui répond et nous n’utilisons pas cette machine à la sonnerie stridente pour les choses sérieuses. »

Un central téléphonique dans les années 1910
Enjoué et un peu moqueur, je rétorque : « Mais madame la comtesse, vous ne croyez pas si bien dire: je ne suis, moi aussi, qu’un serviteur… un serviteur de l’État. »
La comtesse, sur un ton de reproche : « Je suis stupéfaite que vous ayez pu donner des ordres à la police en utilisant cet outil aussi futile. Comment peut-on sérieusement diriger une administration avec ce … jouet de luxe ? »
Je réfléchis un instant : « Vous auriez préféré que j’envoie un agent porter un pli avec mes consignes? Et que j’attende ensuite une ou deux heures son retour pour savoir si nous ne rencontrions pas des difficultés dans l’exécution de celles-ci ? »
La dame ne se laisse pas démonter : « Notre police, cher monsieur, a besoin d’ordres écrits, clairs et non d’appels intempestifs d’un petit conseiller de cabinet qui parle trop vite. Rendez-vous compte que le personnel de ma maison n’utilise même pas le téléphone pour les courses et que mon époux continue à faire poster ses courriers en ville par son chauffeur. »
La comtesse a beau avoir vingt ans de moins que moi, je suis saisi par le décalage entre sa vision du monde et la mienne. Notre dialogue oppose deux époques et presque deux siècles : un XIXème finissant qu’elle représente avec orgueil et un XXème qui commence à peine et dans lequel je suis déjà plongé.
L’aristocrate délicatement parfumée se penche vers moi et me glisse sur le ton de la confidence cet ultime argument : « Savez-vous qu’aucun joli garçon, aucun homme du monde n’oserait entrer en contact avec moi avec un téléphone ? »
Un peu lassé par cet entretien qui me fait prendre du retard dans mes dossiers, je lâche avec un sourire faussement enjôleur : « Mais madame, s’il en est ainsi, je vous promets de ne jamais vous appeler ! »

Vous aimez ce site ? Rejoignez les amis du blog « Il y a un siècle » !