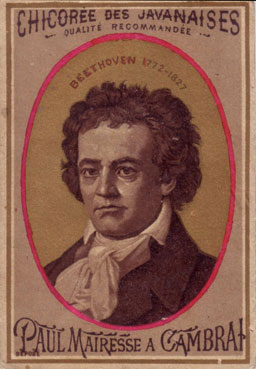Attachant mais exaspérant. Supérieurement intelligent mais parfois ô combien puéril. Longtemps silencieux dans un groupe puis soudain enflammé, caustique, drôle. Du coeur mais aussi de la cruauté.
Je connais Marcel Proust depuis une dizaine d’années. L’affaire Dreyfus nous a rapprochés. Nous étions à l’époque quelques-uns à faire bloc, à élaborer des stratégies de résistance, à nous passer des informations et à nous soutenir mutuellement.

En 1908, année charnière, Marcel Proust revient avec passion au roman et commence à écrire véritablement son oeuvre immense…
J’ai eu aussi l’occasion d’assister à un duel entre Marcel et Jean Lorrain, le second ayant sali le premier publiquement. Je devais rendre compte du résultat de ce combat au pistolet à Mme Arman de Caillavet qui tremblait pour son protégé. Résultat ? Deux balles perdues dans le bois de Meudon au petit matin, aucune blessure, deux tireurs très médiocres… et beaucoup d’inquiétude inutile.
Un ami ? Pas vraiment, plutôt une connaissance. Un homme qui marque, qui intrigue, qu’on est heureux de rencontrer dans une soirée sans savoir quand nos chemins se croiseront à nouveau.
Ses articles dans Le Figaro sont plaisants. On oublie presque le sujet abordé (le dernier recueil d’Anna de Noailles chez Calmann-Lévy par exemple) et se laisse porter par une plume alerte, une sensibilité à fleur de peau, une connaissance intime des oeuvres de John Ruskin, de Francis Jammes ou Maeterlinck qu’il cite, de mémoire, en référence.
Une taille moyenne, les épaules tombantes, mince, pas toujours très bonne mine malgré son teint mat. Le physique de Marcel n’impressionne pas au premier abord. Le regard attire en revanche irrésistiblement. Les paupières tombantes en accentuent parfois sa douceur mais la noirceur des yeux ne cache pas longtemps une palette impressionnante de sentiments. Ironie mordante, colère -Marcel est susceptible – volonté de séduire ou d’être séduit, bonté souvent, dureté parfois. Sa main gauche cherche discrètement son visage, cache à moitié ses lèvres, laisse un doigt pour caresser la moustache soigneusement taillée. Timidité et concentration d’un homme de lettres qui transforme chaque instant en exercice de l’esprit.
Certains le résument à un dandy de salon. A tort. Marcel, souvent souffrant -son terrible asthme- sort de moins en moins. S’il a connaissance de ce qui se passe et se dit dans les dîners en ville, c’est par les rapports que lui font quelques ami(e)s fidèles.
Non, maintenant, il écrit. Sa mère est morte. Blessure profonde qu’il ne peut soigner qu’en écrivant encore. Vite, très bien. Les pages se noircissent avec frénésie. Le travail sur la mémoire, la cuisine des souvenirs, une extraordinaire aisance de plume, conduisent à remplir un cahier, puis un second, un troisième… Il s’enferme. Quelques biscuits, un café, un verre d’eau. Il travaille des heures sans notion du temps. Dehors il fait froid, l’air humide, la crainte de la crise d’asthme, de l’étouffement, poussent à rester au chaud, derrière la table, le dos courbé sur les feuillets qui s’accumulent.
Il annonce à qui veut l’entendre un roman appelé « Contre Sainte-Beuve ». Ce ne sera pas un essai mais une fiction complexe, des centaines de pages où se mêlent des entrelacs de souvenirs de sa mère, de Venise, de Combray. Le drame de se coucher seul, la joie de promenades à la campagne, le sifflet des trains, d’autres sons, des odeurs qui reviennent. L’amour, la tentation homosexuelle, le désir de plaire, de ravir l’autre, de le posséder en rêve, jalousement.
Marcel et moi nous retrouvons une fois par mois au café ou au bar du Ritz. Toujours ce jeu idiot des dominos. Prétexte pour qu’il me lise à haute voix sa production de la nuit. De longues phrases, des « que » s’enchaînent sans lasser. Une façon révolutionnaire de construire un roman qui éloigne la perspective de trouver un éditeur.
» Le mot homosexuel terrifie, l’immoralité de certaines pages fera fuir » lâche-t-il tristement. Je n’ose pas lui dire que sa maladresse vis à vis des patrons de presse le prive de précieux soutiens. Je crains de trop parler. La peur d’être ridicule face à un génie ou de blesser un être ultra sensible.
A un moment donné, il ne parle plus, son regard se perd au loin. Marcel Proust m’a déjà quitté par la pensée. Gardera-t-il quelque chose de notre rencontre ? Quel geste ou attitude a priori banale sera relevée et transformée dans son roman en phrase soyeuse, en description inattendue… et d’un seul coup inoubliable ?

L’écriture de Marcel Proust… sur des milliers de pages…